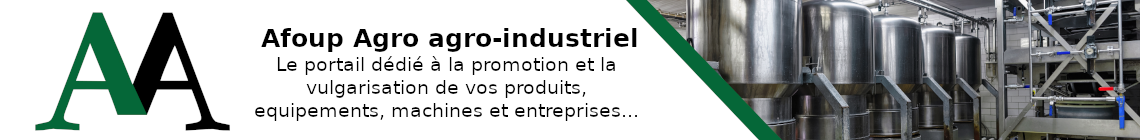No products in the cart.
Return To Shop- Home
- Le saviez-vous
- Les origines amères du café
Les origines amères du café
Malgré la place qu'il peut occuper dans nos vies, le café a un côté sombre - un passé sinistre qui a engendré un présent troublant. Au cours des siècles de production mondiale de café, un thème commun est apparu : l'oppression des personnes de couleur pour le profit
Les origines amères du café
La lutte contre les systèmes d’oppression sociale, économique et environnementale fait partie intégrante de l’action de Heifer International. L’organisation s’efforce de mettre fin à la faim et à la pauvreté tout en prenant soin de la Terre. Toutefois, elle est consciente que la pauvreté n’est pas un accident. Lorsque des groupes spécifiques de personnes connaissent des formes similaires de marginalisation socio-économique, c’est à dessein.
Rédigé par Cory Gilman pour Heifer International
Dans cette série, nous explorons l’intersection du racisme historique et du développement agricole, en examinant l’impact sur les Noirs, les indigènes et les personnes de couleur afin de contextualiser la manière dont des horreurs vieilles de plusieurs siècles continuent de façonner et d’influencer la vie des familles avec lesquelles nous travaillons.
 Pour beaucoup d’entre nous, le café est essentiel. Nous ne pouvons pas imaginer nous réveiller sans lui, et encore moins faire face au creux de la vague de la mi-journée. Il contribue à tisser des liens et à nous rapprocher de ceux que nous aimons, en stimulant notre esprit tout en créant des moments de pure expérience sensorielle. Notre amour collectif grandit pratiquement à chaque minute, comme en témoigne l’augmentation constante du nombre de cafés, de torréfacteurs, de marques en bouteille et de la consommation globale au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, 64 % des Américains boivent du café quotidiennement, ce qui représente environ 400 milliards de tasses par an.
Pour beaucoup d’entre nous, le café est essentiel. Nous ne pouvons pas imaginer nous réveiller sans lui, et encore moins faire face au creux de la vague de la mi-journée. Il contribue à tisser des liens et à nous rapprocher de ceux que nous aimons, en stimulant notre esprit tout en créant des moments de pure expérience sensorielle. Notre amour collectif grandit pratiquement à chaque minute, comme en témoigne l’augmentation constante du nombre de cafés, de torréfacteurs, de marques en bouteille et de la consommation globale au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, 64 % des Américains boivent du café quotidiennement, ce qui représente environ 400 milliards de tasses par an.
Malgré la place qu’il peut occuper dans nos vies, le café a un côté sombre – un passé sinistre qui a engendré un présent troublant. Au cours des siècles de production mondiale de café, un thème commun est apparu : l’oppression des personnes de couleur pour le profit. Comme le dit Christine A. Jones, professeur de langues et de cultures du monde à l’université de l’Utah, “je considère le café comme l’un de ces produits de luxe qui illustrent les juxtapositions profondes du commerce des esclaves ; le travail humain pour exploiter la possibilité du luxe humain.”
Une histoire amère
Il est indéniable que la traite négrière atlantique a joué un rôle essentiel dans le façonnement de l’industrie du café d’aujourd’hui. Pendant 400 ans, environ 11 millions d’Africains ont été capturés et jetés sur des navires négriers, passant le reste de leur vie à échanger, contre leur gré, leur travail et leur bien-être contre un commerce du café qui a stimulé le succès économique et géopolitique des colonies européennes.
Le café est originaire d’Éthiopie, où il pousse encore à l’état sauvage dans des forêts anciennes. Il a fini par atteindre le sud de la péninsule arabique par le port d’Al Mokha. Si l’histoire exacte de son exportation fait l’objet de nombreuses spéculations, de nombreux historiens pensent que les esclaves ont apporté des graines (sous la forme de cerises de café) comme source de nourriture sur le bateau. Il est certain que le Yémen moderne est l’endroit où le café a été cultivé pour la première fois à des fins commerciales.
Au 15e siècle, c’était la boisson la plus populaire de la région, servie dans les cafés aux marchands locaux et aux commerçants vénitiens qui faisaient des affaires. La nouvelle de ce breuvage magique s’est rapidement répandue dans le monde entier, suscitant une énorme demande mondiale. L’Arabie s’est mise à protéger férocement cette culture, interdisant le commerce de ses graines et exigeant même que tous les grains soient bouillis avant d’être exportés pour garantir leur stérilité. Ce monopole du café a été maintenu par l’Empire ottoman jusqu’à la fin des années 1600, lorsque les Hollandais ont volé des graines viables, les faisant sortir clandestinement du Yémen pour les cultiver dans leurs colonies indonésiennes. Les graines de café ont atterri sur l’île de Java, où les Hollandais ont rapidement établi de vastes plantations en utilisant des terres volées et une main-d’œuvre javanaise sous contrat. Le travail était brutal, la mort humaine étant considérée comme un coût de production acceptable. Des villages entiers ont péri de faim, conséquence directe du traitement infligé par les Hollandais.

Au milieu du XVIIIe siècle, les autres puissances européennes étaient parfaitement conscientes de la rentabilité du café. La demande dépassant les capacités de l’Indonésie néerlandaise, les colons britanniques, français, espagnols et portugais se joignent au commerce. Ces puissances mondiales se sont emparées des plantes et des hommes d’Afrique de l’Ouest, expédiant les esclaves comme des marchandises pour établir des plantations dans les Caraïbes et les Amériques. En 1788, la moitié de la production mondiale de café provenait du travail des esclaves africains à Haïti, sous occupation française. Les conditions de travail y étaient marquées par une combinaison de torture, de malnutrition, de surmenage et d’insalubrité. L’idée était de cultiver le café le moins cher possible, au détriment de la vie humaine.
Pendant ce temps, le Brésil, colonisé par les Portugais, s’impose rapidement comme l’un des principaux producteurs de café. Au début des années 1800, le Brésil représentait 30 % de la production mondiale de café, qui était cultivé sur le dos de deux millions de personnes volées en Afrique. Depuis l’époque de l’esclavage, l’espérance de vie moyenne d’un esclave du café au Brésil était d’à peine sept ans, probablement parce qu’il était largement admis parmi les propriétaires de plantations qu’il était moins coûteux d’importer de nouveaux esclaves après qu’ils soient morts de surmenage que de fournir les conditions nécessaires pour les maintenir en vie. Ce système a duré jusqu’en 1888, trois ans après que les États-Unis eurent légalement aboli la pratique de la possession d’êtres humains.
En Amérique centrale, colonisée par les Espagnols, le café dépendait des terres volées et du travail forcé des populations indigènes. Les Mayas et d’autres populations indigènes servaient de “semi-esclaves”, la seule différence réelle étant l’absence de structure juridique formelle pour les biens humains. Et, comme ces groupes occupaient des terres fertiles idéales pour la culture du café, ils ont été déplacés de force et contraints de cultiver leurs terres ancestrales, désormais propriété de leurs tyranniques. Si quelqu’un essayait de maintenir son autonomie, la réponse militaire était violente et brutale.

La propagation simultanée des cafés en Europe a ajouté une autre couche inquiétante à l’histoire du café. Du XVIIe au XIXe siècle, alors que l’esclavage alimentait la production de café, les cafés sont devenus des centres d’activité économique et de commerce. Selon Mark Ellis, auteur de The Coffee House, les marchands se rencontraient pour siroter un café et discuter de “l’acquisition de biens ou de capitaux pour cette même industrie”. Les corps noirs étaient considérés comme les deux, car ils étaient utilisés comme une forme de crédit et négociés dans le cadre de transactions financières. Au milieu de sièges confortables et d’arômes revigorants, il n’était pas rare d’entendre des accords complexes conclus pour des combinaisons de plantes et de personnes.
Une réalité aride : A la ferme
Plus de 600 ans plus tard, le système semble différent à première vue, mais il est choquant de constater que peu de choses ont changé. Dans le prolongement de l’héritage du colonialisme, les personnes de couleur continuent d’être l’épine dorsale de l’industrie, fournissant la main d’œuvre et les grains de café générateurs de richesse avec peu ou pas de compensation. Le fossé entre les nantis et les démunis continue de se creuser dans l’industrie du café, avec un fossé racial et ethnique apparent qui les sépare.

Dans 50 pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie, 125 millions de personnes dépendent du café pour leur subsistance. Parmi elles, 63 % vivent dans la pauvreté et 71 % dans l’extrême pauvreté. Pour les petits producteurs de café, ces chiffres sont proches de 100 %. Presque tous sont des Noirs, des indigènes et des personnes de couleur. Ils travaillent dur parmi les plantes en fleurs, de l’aube au crépuscule, en soignant soigneusement la récolte pour répondre aux exigences des palais les plus exigeants. Tout est fait à la main, depuis la sélection des cerises les plus mûres jusqu’au transport des sacs de 132 livres sur des kilomètres à flanc de montagne. La canopée de la forêt séquestre le carbone et produit de l’humus, tandis que le sol est entretenu avec soin à l’aide de techniques naturelles. De toutes les utilisations des terres agricoles, le café cultivé à l’ombre et géré de manière holistique est considéré comme le plus bénéfique pour la biodiversité.
Ils tiennent soigneusement leurs registres et leur documentation, afin que les acheteurs disposent des informations nécessaires à la traçabilité et à la transparence. Cependant, malgré toutes les choses incroyables que ces agriculteurs font pour leurs communautés et leurs écosystèmes (sans parler des consommateurs), ils sont payés une misère en échange de leur dur labeur et ne gagnent souvent même pas assez pour couvrir les frais de production des grains, sans parler de subvenir aux besoins de leurs familles.
La baisse constante des cours du marché est la norme dans le secteur du café depuis de nombreuses années. Par conséquent, la situation financière des agriculteurs est pire aujourd’hui qu’il y a 50 ans. En 2020, le prix du café est plus de quatre fois inférieur à ce qu’il était au début des années 1980, ce qui, compte tenu de l’inflation, reviendrait à ramener le salaire minimum de 3,35 dollars de l’époque à 0,83 dollar aujourd’hui. Il faut environ 2,30 dollars par livre pour que les producteurs atteignent le seuil de rentabilité à long terme, et entre 1,87 et 3,50 dollars par livre pour atteindre un revenu de subsistance – le revenu net nécessaire pour maintenir un niveau de vie décent.
En conséquence, les ménages sont confrontés à la pénurie d’aliments nutritifs, à l’impossibilité de se faire soigner et à l’incapacité de faire face aux dépenses de base. Les enfants sont de plus en plus souvent retirés de l’école par manque d’argent, et de nombreuses familles s’endettent de manière inéluctable, ce qui leur coûte leur exploitation agricole, voire leur vie. Ainsi se poursuit une approche séculaire consistant à priver les populations de nourriture, de santé, d’éducation, de logement adéquat, etc. afin d’endiguer leur progression.
Une hiérarchie raciale plus visible imprègne les plantations à grande échelle. Les propriétaires des exploitations ont tendance à être d’origine européenne, tandis que les travailleurs agricoles sont largement représentés par des groupes indigènes et des minorités ethniques. Ces travailleurs agricoles sont grossièrement sous-payés, généralement bien en dessous du salaire minimum national. Pendant la saison des récoltes, ils passent des nuits à dormir à 60 sur le sol de pièces sales et exiguës. Les latrines et les douches étant souvent inexistantes, ils utilisent les champs et les rivières à proximité. Le manque d’équipement de protection contre tout, des serpents venimeux aux pesticides toxiques, est la norme, et l’eau potable est rare.
Les travailleurs sont souvent réduits en esclavage, sauf de nom, forcés de rembourser leurs dettes par le travail. Dans les plantations où la main-d’œuvre est permanente, il n’est que trop fréquent d’être à la fois soumis à des salaires de misère et, pour diverses raisons, coupé des marchés locaux. Les “employés” sont contraints d’acheter des produits de première nécessité à des prix exorbitants dans un magasin spécialisé, ce qui les pousse à s’endetter davantage. Il n’est pas rare que les systèmes de paiement soient truqués, par le biais de balances manipulées ou de café mystérieusement égaré lors de la pesée. Tout cela perpétue intentionnellement la servitude sous contrat, car les travailleurs sont ensuite contraints de rester jusqu’à ce qu’ils puissent rembourser ce qu’ils ont emprunté.
L’esclavage moderne, encore plus flagrant, est omniprésent dans le secteur et particulièrement répandu au Brésil. La situation ne semble pas s’améliorer malgré les certifications de produits. En fait, depuis 2014, les responsables du travail ont mené 25 enquêtes sur le travail forcé et d’autres violations des droits de l’homme dans le secteur du café au Brésil, et les experts reconnaissent largement que le nombre de rapports fait pâle figure face à l’ampleur réelle.
Le travail des enfants est également exploité dans le secteur du café, le Brésil étant à nouveau le pire contrevenant. Une étude récente a révélé que les taux d’exploitation du travail des enfants étaient 37 % plus élevés au Brésil que dans les autres pays producteurs de café, des enfants âgés de 6 ans à peine travaillant 10 heures par jour tout en étant exposés à des risques pour la santé et la sécurité. Cette situation est particulièrement remarquable si l’on se souvient de l’histoire d’esclavage du Brésil, qui a été le facteur déterminant de son accession à la domination du café. Aujourd’hui, le Brésil reste le plus grand et le plus influent producteur de café au monde, ce qui permet aux propriétaires de grandes plantations et aux entreprises associées de réaliser des profits considérables.
Related Posts
No Content Available
TRENDING
No Content Available